La société adore les déclics spectaculaires. Un chiffre qui clignote, une photo avant-après, un moment de honte bien calibré pour enclencher la rédemption. Elle aime croire que les corps changent par illumination soudaine, jamais par lente accumulation de fatigue, d’immobilité, de charge mentale et de vie qui déborde. Elle aime surtout les histoires simples. Les corps, eux, sont rarement coopératifs.
Mon déclic à moi a pris la forme d’une balance chez mes parents. Je n’en avais plus chez moi : solution radicale et très mature consistant à supprimer l’objet plutôt que le malaise. Je me suis déshabillée sous le regard de ma mère, parce que rien ne renforce la confiance en soi comme être nue devant celle qui t’a vue naître. Les chiffres ont clignoté : 196 livres. Cent quatre-vingt-seize… L’équivalent d’un bébé éléphant, d’une autruche respectable ou d’une machine à laver pleine grandeur en cycle intensif. J’ai ri en lançant une blague douteuse sur mon allure de Teletubbies, puis j’ai eu envie de pleurer. Parce que ce n’était pas une histoire de poids. C’était une histoire de corps qui ne suivait plus, de souffle court et d’un détail très concret : je n’étais même plus capable d’attacher mes souliers sans avoir l’impression d’être compressée comme un sac sous vide.
« Ah, qu’elle a le dos large, cette pandémie. ». C’est vrai! Mais il faut dire qu’elle avait bien fait son travail. Non pas en me laissant affamée. Je mangeais adéquatement. Mais entre les bouteilles de pinot gris (une bouteille par jour éloigne le COVID pour toujours!), je me suis immobilisée doucement, enveloppée de fatigue mentale et de cette étrange idée que le repos doit toujours être mérité. Alors j’ai décidé de m’offrir un cadeau. Pas un miracle, pas une promesse Instagram, pas une pilule magique. La santé. Quelque chose de franchement peu glamour : un plan nutritionnel raisonnable pour commencer, de l’activité physique à tous les jours et de la constance. Bref, tout ce que la société trouve plate parce que les résultats ne sont pas immédiats. Ce processus est lent et c’est un processus qui se like mal.
C’est le 18 juillet 2021 que j’ai recommencé à bouger. Lentement. Maladroitement. En sacrant beaucoup (énormément!). Le premier entraînement a été un enfer. Le deuxième aussi, mais avec un mince espoir de survie. Puis le corps s’est souvenu. En six mois, cinquante livres ont disparu. Il faut dire que je suis du genre intense. Si je découvre que le gingembre est bon pour la santé, je ne me contente pas d’en manger : j’en mets dans toutes les sauces, mes smoothies, mes tisanes… et, par souci de cohérence, il finit aussi dans mes crèmes, mes huiles et probablement mes chandelles. À ce rythme-là, j’aurais très bien pu basculer dans le culte du fitness, celui où chaque bouchée se calcule, chaque entraînement se sacralise et où la vie entière se résume à des calories et des abdos. J’ai freiné juste à temps : je ne supporte pas les personnes parfaitement en forme qui ne s’entraînent que pour exister.
Ce passage de ma vie n’a fait que confirmer ce que je pensais déjà. Ce n’est pas une illusion : la société ment avec aplomb. Il faut dire qu’elle aime bien les femmes tant qu’elles doutent un peu. Tant qu’elles veulent s’améliorer, se corriger, se lisser, se raffermir, se rajeunir (idéalement en plusieurs paiements mensuels). Une femme qui vieillit tranquillement, qui entretient son corps sans vouloir le réparer, qui ne cherche plus à redevenir quelque chose qu’elle a déjà été, devient rapidement suspecte. Elle consomme moins de solutions miracles, écoute moins les experts autoproclamés et pose des questions franchement embêtantes. Quand une femme cesse de vouloir être corrigée, elle échappe à tout un écosystème très bien huilé. Alors on appelle ça « vieillir ». C’est plus poli que de dire : elle ne joue plus le jeu. On nous vend la minceur comme une valeur morale, les raccourcis chimiques comme des solutions élégantes, et la jeunesse éternelle comme un projet raisonnable (surtout pour les femmes), à condition de ne pas trop vieillir, de ne pas trop s’affaisser, de ne pas trop exister.
Le corps vieillissant de la femme est traité comme une défaillance technique. On nous explique ce qui va tomber, se relâcher, ralentir. On nous propose de le corriger, de le masquer, de l’optimiser. Rarement de l’habiter. Un corps de femme qui vieillit sans s’excuser, qui devient plus fort, plus stable, plus autonome, dérange. Parce qu’un corps capable enlève un marché. Il enlève la honte. Il enlève l’urgence de consommer pour réparer ce qui n’est pas brisé.
Moi, je n’ai pas choisi d’être mince. J’ai choisi d’être fonctionnelle. Pouvoir monter des escaliers sans méditer sur la mort. Porter l’épicerie sans calculer chaque respiration. Vieillir avec assez de force pour demander de l’aide seulement quand c’est réellement nécessaire. J’ai vu ce que ça donne, cette autonomie. J’ai connu cette femme de 75 ans, qui se déplace en vélo été comme hiver, faisant son épicerie seule, propageant cette joie de vivre presque insolente. Elle demandait de l’aide sans honte parce qu’elle savait exactement quand son corps avait atteint une vraie limite. Pas une limite dictée par la peur ou par le discours ambiant.
Ce choix-là, il se voit. Il se ressent. La confiance qu’on développe dans son corps se dégage sur les autres, même quand on ne dit rien. Mes enfants m’ont regardée bouger, persister, transpirer, recommencer. Sans discours. Sans morale. Ils se sont mis en mouvement à leur façon. Et je réalise que c’est probablement le meilleur legs que je pouvais leur offrir : un rapport sain au corps, non pas comme un objet à perfectionner, mais comme un allié à entretenir.
Aujourd’hui, je sue encore (et je sacre encore tout autant à l’entrainement!). Pas pour rentrer dans une taille. Pour garder l’équilibre. Pour durer. Pour être capable. Parce que dans une société qui s’effrite à vitesse grand V, mieux vaut savoir courir, porter, se relever… et faire quelques squats, au cas où il faudrait survivre à l’effondrement civilisationnel en leggings.
Le miroir continuera de mentir. C’est vrai!
La société continuera de projeter ses névroses sur nos corps. Ouais…et alors?
Moi, j’ai choisi autre chose : un corps capable qui se sent vivant, avec assez de force pour rire encore en attachant ses souliers.

« Je préfère être capable que rentable »
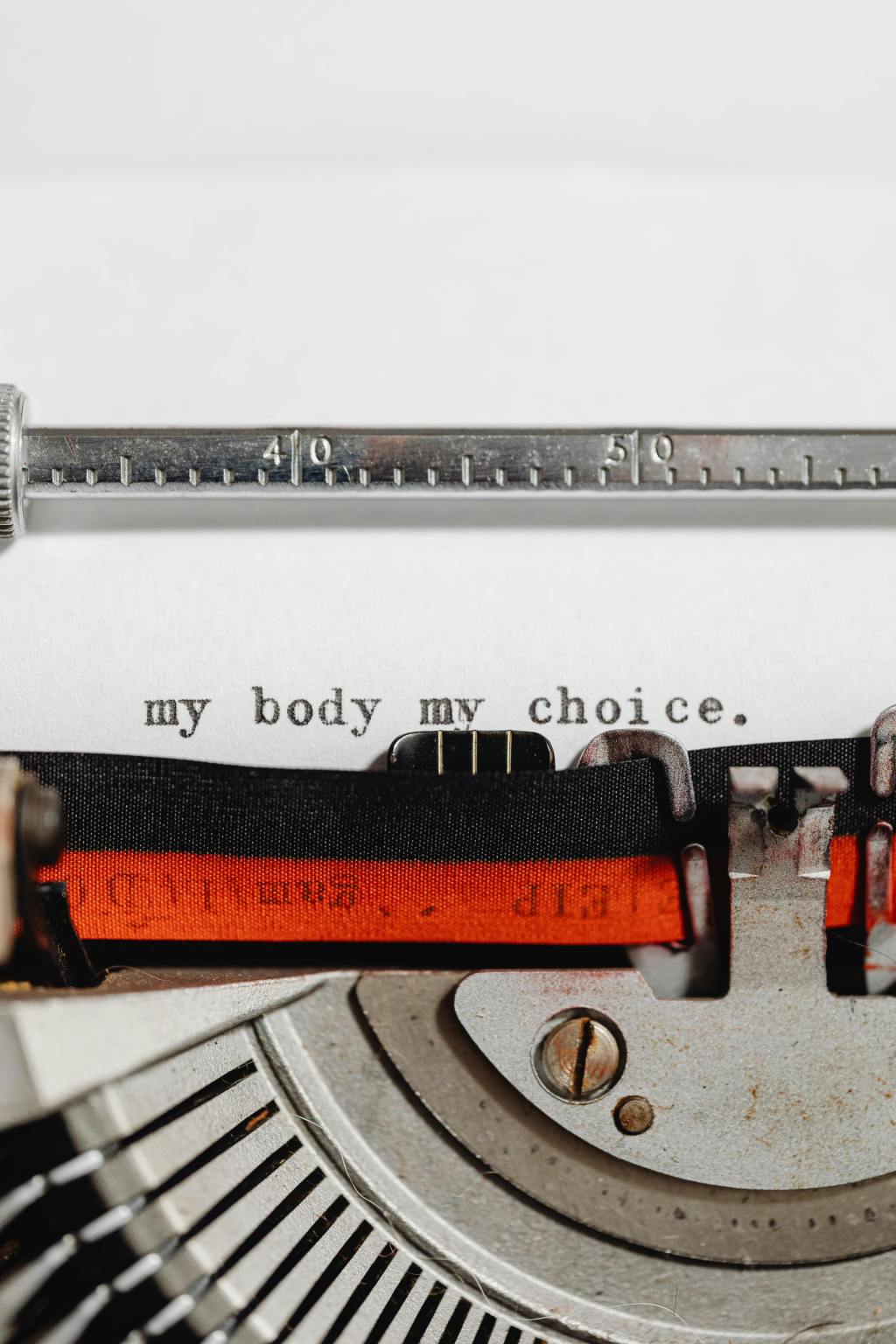
Laisser un commentaire